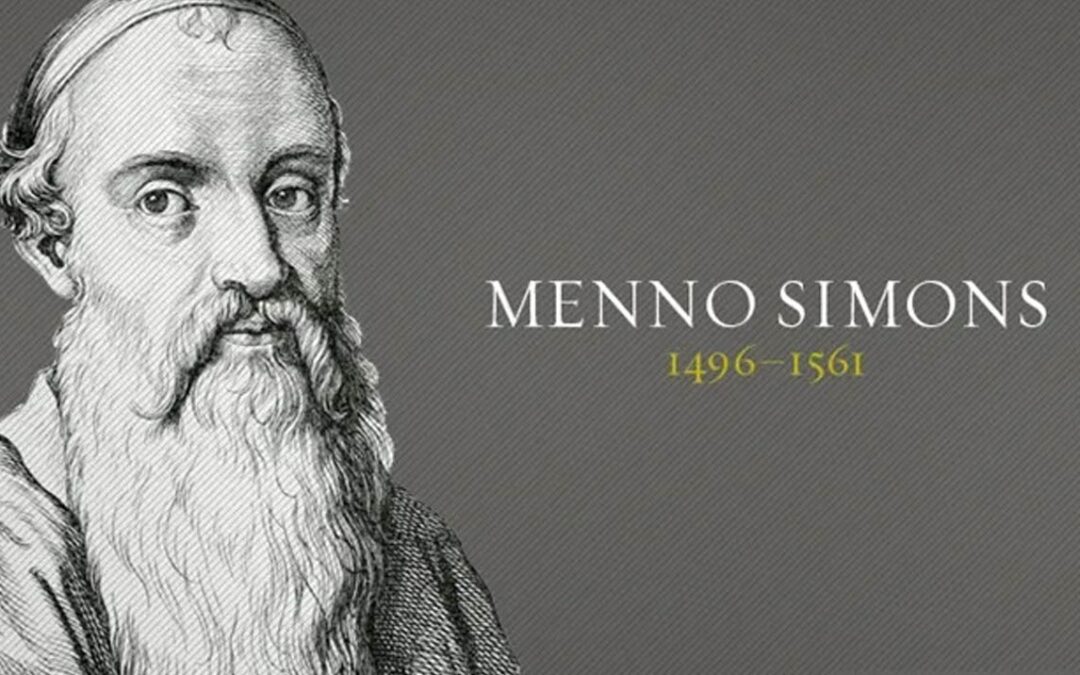Comment peut-on apprécier originellement, historiquement et actuellement l’originalité du courant anabaptiste ?
Harold Bender présentait l’originalité de la « vision anabaptiste[1] » en trois points centraux :
- La suivance du Christ (Nachfolge Christi) comme une transformation de vie, une conformation du disciple chrétien au maître Jésus, un chemin d’acquisition et d’expression des vertus de Jésus, visible de tous.
- L’Église, comprise comme communauté professante, solidaire et fraternelle.
- Une éthique résolument pacifiste et aimante, du frère comme de l’ennemi.
Autrement dit, et bien avant les modernes du XXe siècle, ce courant portait déjà les marqueurs d’une « théologie existentielle[2] » portée et manifestée par une communauté locale, cherchant à vivre conformément à la vie et à l’enseignement de Jésus.
Il y a près de 500 ans, un de ceux qui allait devenir un leader de ce courant, Menno Simons, déclarait:
La vraie foi évangélique, de par sa nature, ne saurait rester inactive. Au contraire, elle se diffuse par toutes sortes d’œuvres de justice, par les fruits de l’amour… Elle habille celui qui est nu; elle nourrit celui qui a faim; elle console l’affligé; elle procure un abri au miséreux; elle soutient et console celui qui est triste; elle recherche ceux qui sont perdus; elle panse celui qui est blessé; elle guérit le malade[3].
Cet accent premier perdure aujourd’hui encore. Par exemple, la confession de foi en vigueur dans les Eglises mennonites de France contient, en proportion égale, des articles de théologie fondamentale (propres à toutes les confessions), des articles de fonctionnement ecclésial (moins mis en avant chez les autres confessions chrétiennes) et des articles d’éthique générale (très peu présents ailleurs).
Comment et en quoi le regard anabaptiste s’est-il ouvert à d’autres regards et en a-t-il été enrichi au cours de ces 500 dernières années ?
Certains considèrent que l’anabaptisme est le sol spirituel d’où vont jaillir tous les mouvements chrétiens non conformistes ultérieurs, le premier programme pour un nouveau type de société chrétienne[4]. D’autres pensent qu’il s’agit d’un mouvement de renouveau qui pourrait s’apparenter aux vaudois ou aux franciscains des 12e et 13e siècles ou encore aux quakers du 17e ou au mouvement pentecôtiste classique du 20e siècle.
Ce mouvement a lui-même été influencé par les courants monastiques du Moyen Âge ou encore les frères Moraves. Au 16e siècle, il interagit avec les réformateurs magistériaux : Luther en Allemagne, Zwingli à Zürich, Bucer à Strasbourg puis Calvin à Genève. Plus tard, il influencera fortement les baptistes qui en reprendront le baptême adulte des croyants. Son pacifisme gagnera les Quakers ou encore les Églises de frères. En appelant à une séparation entre l’Église et l’État, il influencera le mouvement évangélique qui affirme qu’on ne naît pas chrétien, mais qu’on le devient par conviction. Et réciproquement, l’anabaptisme sera renouvelé au fil des siècles par ces différents courants et d’autres encore, notamment le piétisme.
En quoi l’anabaptisme apporte-t-il aujourd’hui une réponse pertinente aux attentes spirituelles actuelles et une inspiration prophétique pour le renouvellement de nos façons de « faire Église » ?
L’anabaptisme a, depuis ses débuts, relié la foi qui est crue à une appartenance (un groupe de croyants) ainsi qu’à un mode de vie (des choix et comportements accordés à ces croyances).
Aujourd’hui, nos sociétés modernes sont fragmentées et violentes. Les accents très individualistes laissent beaucoup de personnes seules. Les grands sujets sociétaux (climat, guerres, migrations, partage des richesses, utilisations des ressources….) questionnent le sens de nos vies et de nos modes de vie.
À ces grands défis, l’anabaptisme répond : tu n’es pas seul, tu appartiens à une communauté de foi et tu y as toute ta place. Ensemble, nous allons nous soutenir face aux tragédies de la vie et poser des gestes porteurs de sens : prendre soin des personnes âgées, encourager les jeunes dans leurs apprentissages, fortifier les couples, soutenir les célibataires, apprendre ensemble à partager en ayant Jésus pour modèle et l’Évangile comme récit structurant. Ces communautés de foi sont des graines d’espérance, des respirations dans une société bien souvent essoufflée, parfois meurtrie et amère.
En ce temps de tensions et de guerres, en quoi et comment la non- violence anabaptiste contribue au rétablissement et au maintien de la paix en ce monde ?
Plus d’un million de personnes en 2023 ont vu au cinéma le film « je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. C’est une magnifique interprétation de la justice restaurative, une forme de justice qui n’est pas axée sur la punition du coupable, mais sur la restauration des victimes et la réintégration dans la société des agresseurs. La seule chose que le film ne dit pas, c’est que l’initiateur de ce mouvement de justice restaurative est un criminologue mennonite, Howard Zehr, inspiré par sa foi anabaptiste et sa vie d’Église[5].
Dans le déchirement que constitue un meurtre, un viol, une agression physique ou verbale ou, à une autre échelle, une guerre, il y a un travail de réparation et de guérison à mener. A un niveau individuel, mais aussi au niveau de la société. L’anabaptisme a développé des ressources pour cela[6].
On peut aussi prendre le mal plus en amont. Le pacifisme anabaptiste est une invitation à une action non-violente, dans tous les moments du conflit. Lorsque celui-ci est encore en gestation (prévention), lorsqu’il éclate au grand jour (limitation de sa destructivité) et lorsqu’il se termine (réparation)[7].
En quoi et comment, le courant anabaptiste prend-il en compte la vision nouvelle de l’écologie ?
Le Psaume 85 nous parle d’un salut où justice et paix s’embrassent. La paix si chère à l’anabaptisme est intimement liée à la justice. Cette justice se conjugue à tous les niveaux y compris une justice climatique et, plus largement, écologique. Il s’agit alors d’examiner notre rapport aux ressources terrestres, à leur utilisation, à leur partage.
Depuis quelques années, les Églises mennonites de France célèbrent un culte annuel autour du thème du soin de la Création. Les canevas proposés pour ces cultes intègrent à la fois des éléments de théologie : Dieu créateur, l’humain intendant de la création mais aussi des éléments de mise en pratique : invitations à diminuer notre consommation, propositions d’actions à mener et à soutenir dans la durée. Notre Église locale a par exemple organisé une journée « couture » pour réparer nos vêtements plutôt que de les jeter.
Ces actions peuvent sembler bien petites, mais nous savons que tout apprentissage débute modestement. Un enfant d’un an ne court pas un marathon mais fait des premiers pas que ses parents célèbrent. Encouragé et valorisé dans son effort, il poursuivra jusqu’à pouvoir marcher aisément. Certains d’entre nous pratiquent des modes de vie très respectueux de la Création, d’autres débutent seulement. Nous croyons que les plus avancés sur ce sujet peuvent accompagner ceux qui débutent, voilà toute la force et la pertinence d’une communauté où l’on apprend à marcher ensemble, à des rythmes différents, en nous sachant aimés et accompagnés par Jésus lui-même.
Neal Blough
[1] Bender présenta cette vision dans un discours à l’American Society of Church History en 1943. Une traduction française, légèrement retouchée, a été publiée par l’Association Française d’Histoire Anabaptiste Mennonite (A.F.H.A.M.) & Éditions Mennonites, Vision et spiritualité anabaptistes, Montbéliard, Éditions Mennonites, coll. les dossiers de Christ Seul, n°4/2001, p. 9-48.
[2] Nous reprenons cette qualification de « théologie existentielle » de Robert Friedmann, La théologie de l’anabaptisme. Une interprétation, traduit de l’anglais par François Caudwell, les Ponts-de-Martel, éditions de La Talwogne, 2016.
[3] Cité d’après John Driver, trad. F. Caudwell, Vivre Ensemble, unis dans l’Esprit : une spiritualité radicale pour le 21e siècle, Goshen, Indiana, MWC, p. 10.
[4] Rufus M. Jones, cité d’après A.F.H.A.M. & Éditions Mennonites, Vision et spiritualité anabaptistes, op. cit., p. 10.
[5] Pour une première approche, voir Howard Zehr, La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, traduit de l’anglais (USA) par Pascale Renaud-Grobras, coll. le champ éthique n°57, Genève, Labor et Fides, 2012. Pour une approche plus complète, voir Howard Zehr (éd.), Changing lenses: a new focus for crime and justice, Scottdale, Herald Press, 1990.
[6] Pour ceux qui lisent l’anglais, voir la collection the little books of justice and peacebuilding. Présentation de cette collection en ligne, sur https://emu.edu/cjp/resources/little-books
[7] Voir par exemple F. De Coninck, B. Isaak-Krauss, A. Nussbaumer, On n’aime guerre que la paix…. Qu’en disent les Églises pacifistes ?, coll. les dossiers de Christ Seul, Montbéliard, Éditions Mennonites, 2024. On consultera en particulier le témoignage d’Andrea Shalay (p. 49-53) sur la résistance non violente menée par les habitants de Kherson en Ukraine à la suite de l’invasion russe. L’auteur présente au lecteur la force collective de cette non-résistance active, ses limites, ses frontières parfois fines avec une résistance violente.